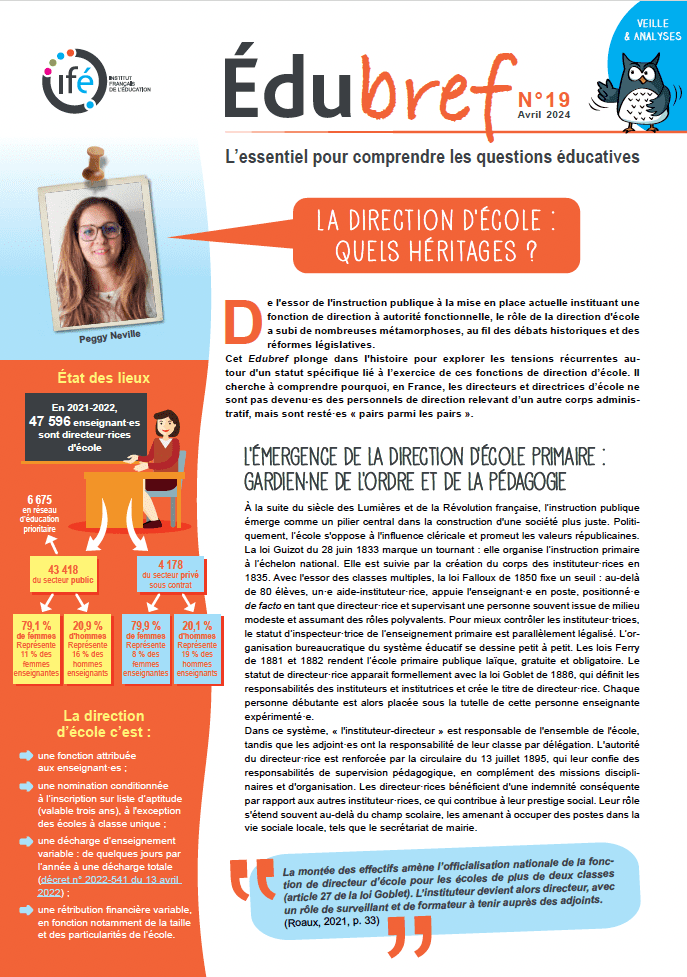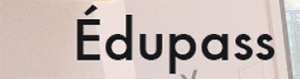Pays : France
Langue(s) : français
Auteur(s) : MIGNOT-GÉRARD Stéphanie
Date de soutenance : 2006
Thèse délivrée par : Sciences Po Paris (IEP)
Section(s) CNU : NSP
Discipline(s) : Sociologie
Sous la direction de : Christine MUSSELIN
Jury de thèse : Christine Musselin, Catherine Paradeise, Georges Felouzis, Emmanuel Lazega, Frédérique Pallez,Josette Soulas
Dans cette thèse, on tente de décrypter les ressorts du leadership dans l’organisation universitaire à partir du cas des universités françaises. Selon l’auteur, la longue tradition de recherches consacrées à l’étude du leadership à l’université présentent deux limites. D’une part, les travaux qui s’intéressent aux dirigeants universitaires reposent sur une vision personnalisée du pouvoir institutionnel, ce qui les conduit à restreindre leur champ d’étude à une position de responsabilité particulière, le plus souvent celle du président d’université. Les autres recherches insistent sur les singularités de l’organisation universitaire et interrogent leur incidence sur les possibilités d’action de ses dirigeants, mais laissent trop souvent dans l’ombre le rôle joué par ces derniers dans les projets de changement organisationnel. La thèse propose donc une approche alternative, qui permette simultanément de saisir la dimension plurielle du leadership et d’examiner le rôle concret des responsables universitaires. Elle s’appuie sur un matériau empirique composé de données qualitatives et quantitatives : une première enquête, réalisée dans quatre universités en 1998, a donné lieu à la réalisation de 250 entretiens ; elle a été complétée par une enquête quantitative (1660 questionnaires dans trente-sept établissements) qui fournit un panorama représentatif de la situation des universités françaises. La thèse est structurée en deux parties. Dans la première partie est développée une conception élargie du gouvernement de l’université. Au lieu de se focaliser sur la figure du président d’université, l’approche adoptée consiste à replacer celui-ci dans son réseau de relations avec l’ensemble des acteurs participant de près ou de loin à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions collectives ou des politiques d’établissement : les dirigeants élus, les administratifs, et les instances. Nous avons interrogé l’incidence du renforcement du pouvoir du président sur l’influence de ces différents acteurs dans les processus décisionnels, mais aussi la manière dont ces acteurs monnayaient leur participation au gouvernement de l’université. Le premier chapitre montre que présidents et directeurs d’UFR ne sont pas des alliés « naturels ». D’une part, les deux acteurs ne partagent pas la même conception de leur rôle de dirigeant universitaire : les premiers se considèrent comme des managers, les seconds sont plus proches de la figure du primus inter pares. En outre, les directeurs d’UFR sont souvent tenus à l’écart des équipes présidentielles et ils participent rarement à l’élaboration des politiques d’établissement. Quand ils sont associés au gouvernement de l’université, leur coopération avec les présidents repose sur des concessions fortes de chaque côté. Le second chapitre traite de la place occupée par l’administration dans le gouvernement des universités. L’administration universitaire a une capacité de rationalisation limitée qui tient au manque de cohésion entre ses services centraux et ses services d’UFR. Par ailleurs, elle tient une place différenciée dans le gouvernement des établissements : tantôt elle supplante les élus à la présidence, tantôt elle est associée ponctuellement à la mise en œuvre de leurs choix, tantôt elle est en étroite coopération avec ces derniers. Nous avons, dans le troisième chapitre, questionné le rôle joué par les instances délibératives dans les processus de décision. La littérature décrit souvent la relation entre les membres de l’exécutif présidentiel et ceux de la filière délibérative comme un jeu de pouvoir à somme nulle : soit les instances sont dépossédées de leur pouvoir de décision par la présidence, soit elles sont en opposition avec les équipes de direction. Si ces deux situations existent, elles n’épuisent pas la réalité. Dans les cas étudiés, les instances ne prennent pas elles-mêmes les décisions, mais elles débattent et travaillent sur les propositions des équipes de direction, jouant ainsi un rôle de surveillance de ces dernières. Par ailleurs, on montre que certaines ont une fonction de légitimation des décisions de l’exécutif. Après la description des relations bilatérales entre le président, les directeurs d’UFR, les membres de l’administration et les instances, se pose la question de savoir comment s’articulent les relations entre les filières élues, administratives et délibératives au sein du gouvernement de chaque université. Dans le quatrième chapitre, les styles de gouvernement des établissements de l’enquête qualitative sont donc reconstruits et comparés aux styles de gouvernement des trente-sept établissements de l’enquête quantitative. La typologie réalisée révèle que les styles de gouvernement en présence dans les universités françaises sont variés mais que certaines configurations relationnelles sont plus fréquentes que d’autres. Cette typologie suggère par conséquent que le « gouvernement » est avant tout un construit social, mais qui n’est pas entièrement contingent et dont on peut reconstituer les logiques endogènes. Le cinquième et dernier chapitre de la partie tire les principaux enseignements de cette conception collective du gouvernement de l’université. On y montre que gouverner suppose de construire des alliances qui ne sont pas sans incidences pour le président. Ainsi, les directeurs d’UFR témoignent leur solidarité aux politiques universitaires si des concessions sont faites à leurs intérêts facultaires ; les responsables administratifs travaillent d’autant mieux avec le président que celui-ci partage leurs valeurs managériales ; quant aux élus des instances, ils entérinent les décisions présidentielles à condition qu’on leur reconnaisse le statut d’interlocuteurs dignes d’être convaincus. La coopération entre un président et ses différents partenaires repose donc sur des échanges dont les modalités diffèrent, et c’est cette incompatibilité des échanges qui permet d’expliquer la prédominance de certains styles de gouvernement. Finalement, les trocs multiplexes qui structurent la coopération entre le président et ses « associés-rivaux » et le caractère exclusif des alliances ainsi bâties permettent d’avancer l’hypothèse d’une stabilité des construits relationnels que l’on a appelés « styles de gouvernement ». Un des effets de la politique contractuelle est d’avoir poussé les présidents des universités françaises à afficher et à définir des priorités, à développer des projets collectifs dans la plupart des registres de l’administration de leur établissement, aussi bien dans le domaine de la gestion que dans celui de l’enseignement et de la recherche. La seconde partie de la thèse s’intéresse ainsi à ces actions que l’on réunit couramment sous la formule de « politiques d’établissement ». Leur élaboration et leur mise en œuvre sont analysées. Le sixième chapitre, qui est consacré à l’étude des politiques d’établissement et aux mécanismes d’allocation des ressources (budgets et postes), permet de mettre en lumière la double ambivalence de l’action des équipes présidentielles. D’une part en effet, les projets initiés par ces dernières ont deux dimensions conjointes. Elles visent d’un côté à affermir le contrôle sur l’activité des enseignants-chercheurs, à réguler les productions universitaires sur des critères de coûts, à limiter les dépenses. De ce point de vue, elles sont porteuses d’une rationalisation gestionnaire. Mais d’un autre côté, les actions de contrôle s’adressent aux entités les moins intégrées à l’établissement, l’allocation des moyens privilégie le maintien des grands équilibres sur les choix discriminants ; enfin, la gestion de l’offre de formation et de la recherche vise à aider l’ensemble des composantes à mieux répondre aux attentes des stakeholders des établissements. La « rationalisation » à l’œuvre dans les universités françaises n’est donc pas purement instrumentale, elle a aussi pour but une plus forte intégration collective. Le second constat mis en évidence dans ce chapitre concerne la nature équivoque de l’autonomie institutionnelle. On observe en effet que les politiques d’établissement, pourtant censées refléter la plus grande autonomie des universités, sont pour la plupart des traductions d’orientations ministérielles. L’étude de la mise en œuvre des politiques d’établissement, qui est conduite dans le septième chapitre, amène également à des conclusions nuancées. D’un côté, les limites de l’action managériale à l’université apparaissent de manière flagrante. Les projets lancés par les établissements qui visent à affermir le contrôle organisationnel sur les activités d’enseignement et de recherche, les politiques qui cherchent à limiter l’expansion des projets disciplinaires dans l’optique de baisse des coûts sont plutôt mal accueillis par les enseignants-chercheurs qui y opposent des résistances, la plupart du temps efficaces. De plus, si certains projets suscitent l’adhésion des universitaires, ils affectent partiellement leurs pratiques. Mais d’un autre côté, sous certaines conditions, les représentants disciplinaires acceptent le principe de mieux gérer les ressources existantes et certains établissements réussissent à la marge à réguler les projets de développements des disciplines. Le huitième chapitre s’interroge sur les possibilités de généralisation des constats réalisés sur le cas français. Ces derniers sont confrontés à des études empiriques portant sur la mise en œuvre de pratiques managériales dans des universités anglo-saxonnes, notamment américaines. Deux constats transversaux se dégagent de cette comparaison. D’une part, les interventions managériales sur les activités et les productions universitaires aboutissent rarement sans le consentement, au moins tacite, des enseignants-chercheurs. D’autre part, l’allocation des moyens à l’université ne se fonde jamais sur des critères normalisés strictement comptables. Trois facteurs se conjuguent et préviennent l’introduction d’un « management dur » à l’université. Le premier tient aux particularités de l’organisation universitaire, c’est-à-dire autant à ses modes de production particuliers qu’aux valeurs prédominantes de ses membres. Par ailleurs, les universitaires savent utiliser leurs marges de manœuvres pour se prémunir des politiques organisationnelles qui vont à l’encontre de leurs intérêts individuels et collectifs. Le troisième facteur est la capacité des enseignants-chercheurs à désamorcer des politiques managériales par l’argumentation. Ainsi, les justifications professionnelles de leurs résistances convainquent souvent les dirigeants universitaires ; de plus, les enseignants savent user de contre-arguments fondés sur des valeurs entrepreneuriales auxquelles les présidents et les membres de leurs équipes sont sensibles. La mise en œuvre de projets managériaux dans les universités françaises est donc difficile, mais pas impossible : les dirigeants universitaires qui parviennent à articuler leur projet d’établissement à un discours rassembleur et à se saisir simultanément des procédures d’évaluation des disciplines imposées par le ministère réussissent à imposer une régulation collective. Toutefois, au bout du compte, le processus de « managérialisation » des universités françaises est moins abrupt qu’il ne l’est dans les universités anglosaxonnes : les dispositifs de contrôle de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement y sont moins intrusifs et les choix d’allocation des ressources nettement moins discriminants. Finalement, parce qu’il passe par des alliances avec des « associés-rivaux », parce qu’il agit par la persuasion et des formes indirectes de contrôle, le gouvernement de l’université française à la fin de années 1990 semble relever d’un savoir-faire politique qui consiste à agencer des relations de pouvoir et à manipuler des arguments, plus qu’il ne repose sur la maîtrise de techniques de gestion ou dans l’accumulation de ressources économiques ou sociales.
Echanger et argumenter. Les dimensions politiques du gouvernement des universités françaises
Auteur(s) : MIGNOT-GÉRARD Stéphanie
Date de soutenance : 2006
Thèse délivrée par : Sciences Po Paris (IEP)
Section(s) CNU : NSP
Discipline(s) : Sociologie
Sous la direction de : Christine MUSSELIN
Jury de thèse : Christine Musselin, Catherine Paradeise, Georges Felouzis, Emmanuel Lazega, Frédérique Pallez,Josette Soulas
Dans cette thèse, on tente de décrypter les ressorts du leadership dans l’organisation universitaire à partir du cas des universités françaises. Selon l’auteur, la longue tradition de recherches consacrées à l’étude du leadership à l’université présentent deux limites. D’une part, les travaux qui s’intéressent aux dirigeants universitaires reposent sur une vision personnalisée du pouvoir institutionnel, ce qui les conduit à restreindre leur champ d’étude à une position de responsabilité particulière, le plus souvent celle du président d’université. Les autres recherches insistent sur les singularités de l’organisation universitaire et interrogent leur incidence sur les possibilités d’action de ses dirigeants, mais laissent trop souvent dans l’ombre le rôle joué par ces derniers dans les projets de changement organisationnel. La thèse propose donc une approche alternative, qui permette simultanément de saisir la dimension plurielle du leadership et d’examiner le rôle concret des responsables universitaires. Elle s’appuie sur un matériau empirique composé de données qualitatives et quantitatives : une première enquête, réalisée dans quatre universités en 1998, a donné lieu à la réalisation de 250 entretiens ; elle a été complétée par une enquête quantitative (1660 questionnaires dans trente-sept établissements) qui fournit un panorama représentatif de la situation des universités françaises. La thèse est structurée en deux parties. Dans la première partie est développée une conception élargie du gouvernement de l’université. Au lieu de se focaliser sur la figure du président d’université, l’approche adoptée consiste à replacer celui-ci dans son réseau de relations avec l’ensemble des acteurs participant de près ou de loin à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions collectives ou des politiques d’établissement : les dirigeants élus, les administratifs, et les instances. Nous avons interrogé l’incidence du renforcement du pouvoir du président sur l’influence de ces différents acteurs dans les processus décisionnels, mais aussi la manière dont ces acteurs monnayaient leur participation au gouvernement de l’université. Le premier chapitre montre que présidents et directeurs d’UFR ne sont pas des alliés « naturels ». D’une part, les deux acteurs ne partagent pas la même conception de leur rôle de dirigeant universitaire : les premiers se considèrent comme des managers, les seconds sont plus proches de la figure du primus inter pares. En outre, les directeurs d’UFR sont souvent tenus à l’écart des équipes présidentielles et ils participent rarement à l’élaboration des politiques d’établissement. Quand ils sont associés au gouvernement de l’université, leur coopération avec les présidents repose sur des concessions fortes de chaque côté. Le second chapitre traite de la place occupée par l’administration dans le gouvernement des universités. L’administration universitaire a une capacité de rationalisation limitée qui tient au manque de cohésion entre ses services centraux et ses services d’UFR. Par ailleurs, elle tient une place différenciée dans le gouvernement des établissements : tantôt elle supplante les élus à la présidence, tantôt elle est associée ponctuellement à la mise en œuvre de leurs choix, tantôt elle est en étroite coopération avec ces derniers. Nous avons, dans le troisième chapitre, questionné le rôle joué par les instances délibératives dans les processus de décision. La littérature décrit souvent la relation entre les membres de l’exécutif présidentiel et ceux de la filière délibérative comme un jeu de pouvoir à somme nulle : soit les instances sont dépossédées de leur pouvoir de décision par la présidence, soit elles sont en opposition avec les équipes de direction. Si ces deux situations existent, elles n’épuisent pas la réalité. Dans les cas étudiés, les instances ne prennent pas elles-mêmes les décisions, mais elles débattent et travaillent sur les propositions des équipes de direction, jouant ainsi un rôle de surveillance de ces dernières. Par ailleurs, on montre que certaines ont une fonction de légitimation des décisions de l’exécutif. Après la description des relations bilatérales entre le président, les directeurs d’UFR, les membres de l’administration et les instances, se pose la question de savoir comment s’articulent les relations entre les filières élues, administratives et délibératives au sein du gouvernement de chaque université. Dans le quatrième chapitre, les styles de gouvernement des établissements de l’enquête qualitative sont donc reconstruits et comparés aux styles de gouvernement des trente-sept établissements de l’enquête quantitative. La typologie réalisée révèle que les styles de gouvernement en présence dans les universités françaises sont variés mais que certaines configurations relationnelles sont plus fréquentes que d’autres. Cette typologie suggère par conséquent que le « gouvernement » est avant tout un construit social, mais qui n’est pas entièrement contingent et dont on peut reconstituer les logiques endogènes. Le cinquième et dernier chapitre de la partie tire les principaux enseignements de cette conception collective du gouvernement de l’université. On y montre que gouverner suppose de construire des alliances qui ne sont pas sans incidences pour le président. Ainsi, les directeurs d’UFR témoignent leur solidarité aux politiques universitaires si des concessions sont faites à leurs intérêts facultaires ; les responsables administratifs travaillent d’autant mieux avec le président que celui-ci partage leurs valeurs managériales ; quant aux élus des instances, ils entérinent les décisions présidentielles à condition qu’on leur reconnaisse le statut d’interlocuteurs dignes d’être convaincus. La coopération entre un président et ses différents partenaires repose donc sur des échanges dont les modalités diffèrent, et c’est cette incompatibilité des échanges qui permet d’expliquer la prédominance de certains styles de gouvernement. Finalement, les trocs multiplexes qui structurent la coopération entre le président et ses « associés-rivaux » et le caractère exclusif des alliances ainsi bâties permettent d’avancer l’hypothèse d’une stabilité des construits relationnels que l’on a appelés « styles de gouvernement ». Un des effets de la politique contractuelle est d’avoir poussé les présidents des universités françaises à afficher et à définir des priorités, à développer des projets collectifs dans la plupart des registres de l’administration de leur établissement, aussi bien dans le domaine de la gestion que dans celui de l’enseignement et de la recherche. La seconde partie de la thèse s’intéresse ainsi à ces actions que l’on réunit couramment sous la formule de « politiques d’établissement ». Leur élaboration et leur mise en œuvre sont analysées. Le sixième chapitre, qui est consacré à l’étude des politiques d’établissement et aux mécanismes d’allocation des ressources (budgets et postes), permet de mettre en lumière la double ambivalence de l’action des équipes présidentielles. D’une part en effet, les projets initiés par ces dernières ont deux dimensions conjointes. Elles visent d’un côté à affermir le contrôle sur l’activité des enseignants-chercheurs, à réguler les productions universitaires sur des critères de coûts, à limiter les dépenses. De ce point de vue, elles sont porteuses d’une rationalisation gestionnaire. Mais d’un autre côté, les actions de contrôle s’adressent aux entités les moins intégrées à l’établissement, l’allocation des moyens privilégie le maintien des grands équilibres sur les choix discriminants ; enfin, la gestion de l’offre de formation et de la recherche vise à aider l’ensemble des composantes à mieux répondre aux attentes des stakeholders des établissements. La « rationalisation » à l’œuvre dans les universités françaises n’est donc pas purement instrumentale, elle a aussi pour but une plus forte intégration collective. Le second constat mis en évidence dans ce chapitre concerne la nature équivoque de l’autonomie institutionnelle. On observe en effet que les politiques d’établissement, pourtant censées refléter la plus grande autonomie des universités, sont pour la plupart des traductions d’orientations ministérielles. L’étude de la mise en œuvre des politiques d’établissement, qui est conduite dans le septième chapitre, amène également à des conclusions nuancées. D’un côté, les limites de l’action managériale à l’université apparaissent de manière flagrante. Les projets lancés par les établissements qui visent à affermir le contrôle organisationnel sur les activités d’enseignement et de recherche, les politiques qui cherchent à limiter l’expansion des projets disciplinaires dans l’optique de baisse des coûts sont plutôt mal accueillis par les enseignants-chercheurs qui y opposent des résistances, la plupart du temps efficaces. De plus, si certains projets suscitent l’adhésion des universitaires, ils affectent partiellement leurs pratiques. Mais d’un autre côté, sous certaines conditions, les représentants disciplinaires acceptent le principe de mieux gérer les ressources existantes et certains établissements réussissent à la marge à réguler les projets de développements des disciplines. Le huitième chapitre s’interroge sur les possibilités de généralisation des constats réalisés sur le cas français. Ces derniers sont confrontés à des études empiriques portant sur la mise en œuvre de pratiques managériales dans des universités anglo-saxonnes, notamment américaines. Deux constats transversaux se dégagent de cette comparaison. D’une part, les interventions managériales sur les activités et les productions universitaires aboutissent rarement sans le consentement, au moins tacite, des enseignants-chercheurs. D’autre part, l’allocation des moyens à l’université ne se fonde jamais sur des critères normalisés strictement comptables. Trois facteurs se conjuguent et préviennent l’introduction d’un « management dur » à l’université. Le premier tient aux particularités de l’organisation universitaire, c’est-à-dire autant à ses modes de production particuliers qu’aux valeurs prédominantes de ses membres. Par ailleurs, les universitaires savent utiliser leurs marges de manœuvres pour se prémunir des politiques organisationnelles qui vont à l’encontre de leurs intérêts individuels et collectifs. Le troisième facteur est la capacité des enseignants-chercheurs à désamorcer des politiques managériales par l’argumentation. Ainsi, les justifications professionnelles de leurs résistances convainquent souvent les dirigeants universitaires ; de plus, les enseignants savent user de contre-arguments fondés sur des valeurs entrepreneuriales auxquelles les présidents et les membres de leurs équipes sont sensibles. La mise en œuvre de projets managériaux dans les universités françaises est donc difficile, mais pas impossible : les dirigeants universitaires qui parviennent à articuler leur projet d’établissement à un discours rassembleur et à se saisir simultanément des procédures d’évaluation des disciplines imposées par le ministère réussissent à imposer une régulation collective. Toutefois, au bout du compte, le processus de « managérialisation » des universités françaises est moins abrupt qu’il ne l’est dans les universités anglosaxonnes : les dispositifs de contrôle de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement y sont moins intrusifs et les choix d’allocation des ressources nettement moins discriminants. Finalement, parce qu’il passe par des alliances avec des « associés-rivaux », parce qu’il agit par la persuasion et des formes indirectes de contrôle, le gouvernement de l’université française à la fin de années 1990 semble relever d’un savoir-faire politique qui consiste à agencer des relations de pouvoir et à manipuler des arguments, plus qu’il ne repose sur la maîtrise de techniques de gestion ou dans l’accumulation de ressources économiques ou sociales.