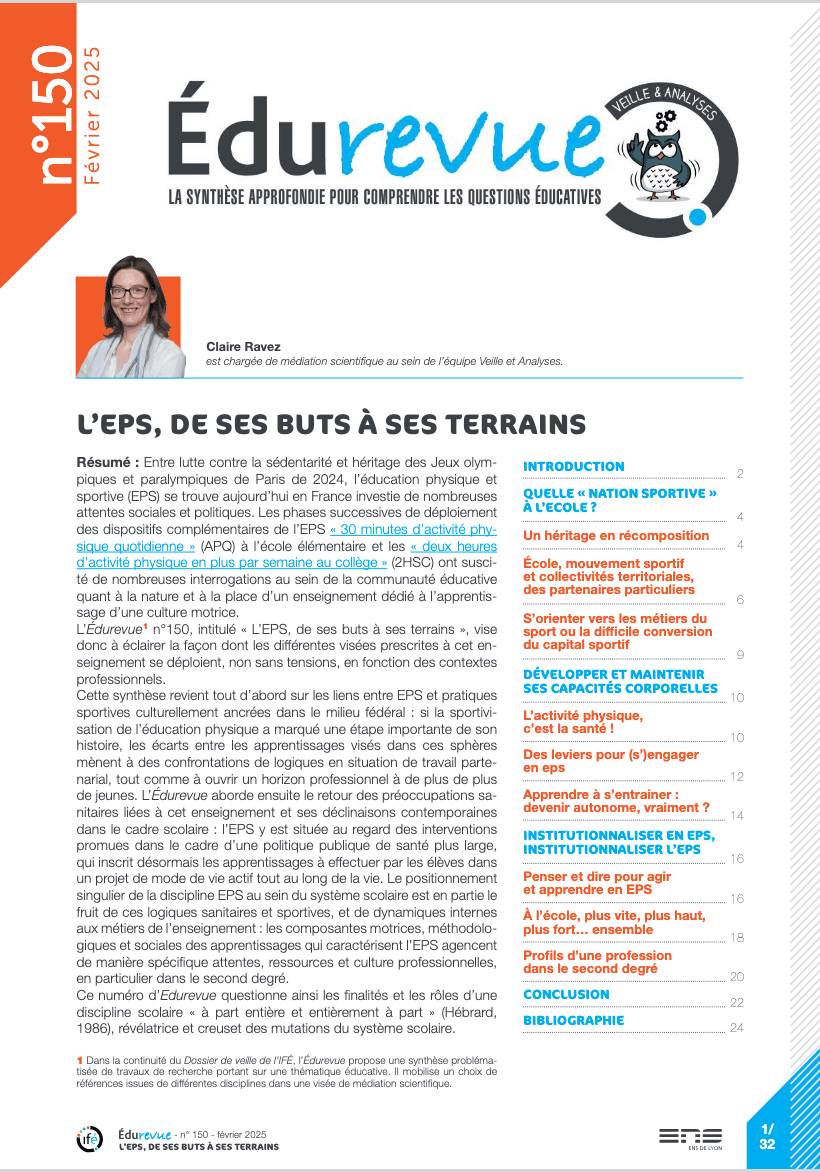Sur le chemin de l'université, une histoire studieuse (3/4). Fédérons-nous! Quand les femmes s'imposent à l'université
Programme source : Le Cours de l'histoire
Produit par : France Culture, Xavier MAUDUIT
Animé par : Xavier MAUDUIT
Intervenant(s) : HUNYADI Marie-Elise
Au 19ᵉ siècle, les premières étudiantes font office de pionnières. Dans cette histoire internationale, la Fédération internationale des femmes diplômées des universités joue un rôle actif pour permettre l'accès d'un plus grand nombre de femmes aux études supérieures.
Dans l’amphithéâtre, nous voici dans un monde particulièrement masculin, garni d’étudiants en costume sombre. Année après année – ou plutôt décennie après décennie – voici que des visages féminins apparaissent. C'est le fruit d’une lutte de longue haleine, celle des pionnières de l’université.
Les premières étudiantes en France
L'accès des femmes aux études supérieures se met en place très lentement en France. Les exemples sont rares et les premières femmes étudiantes restent longtemps des pionnières. Pour s'asseoir sur les bancs de l'université, il faut avoir le diplôme du baccalauréat, or l'enseignement secondaire public pour les jeunes filles n'est instauré que sous la Troisième République avec la loi de Camille Sée de 1880 – quand les lycées pour garçons sont créés dès 1802 par Napoléon Bonaparte. Toutefois, un obstacle demeure : le latin ne fait pas partie des disciplines enseignées aux jeunes filles, ce qui les empêche de passer le baccalauréat, sauf sur leur initiative personnelle. "L'enjeu [de la loi de 1880] est de retirer le poids de l'emprise de l'Église sur l'éducation des filles plus que de leur offrir une formation intellectuelle qui permette de les émanciper par le travail", précise Marie-Élise Hunyadi, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest et autrice de L'Accès des femmes aux études universitaires. L'engagement de la Fédération internationale des femmes diplômées des universités (1919-1970) (Presses universitaires de Rennes, 2024).
Quelques femmes au profil particulier se trouvent pourtant dans les amphithéâtres : Julie-Victoire Daubié, première Française à obtenir le baccalauréat en 1861, est appuyée par le milieu saint-simonien ; Madeleine Brès, une veuve qui doit subvenir aux besoins de ses enfants, est admise à la faculté de médecine en 1868, sans pour autant avoir le droit de passer les concours. L'accès est plus aisé pour les étudiantes venues de l'étranger, qui peuvent obtenir une équivalence de leur diplôme national et s'inscrire aux universités françaises, telles Mary Putnam, Catherine Gontcharoff et Elizabeth Garrett, toujours en 1868. "Les femmes s'engouffrent dans les non-dits législatifs, puisque rien ne leur interdit de pouvoir passer le baccalauréat et d'entrer en tant qu'étudiantes sur les bancs des facultés. C'est plutôt l'usage qui fait que ce n'est pas conçu pour elles. On n'imagine pas qu'elles vont ensuite vouloir embrasser les professions intellectuelles", explique Marie-Élise Hunyadi.
Une vision sexiste des femmes à surmonter
Les obstacles auxquels font face les femmes tiennent de la répartition genrée des rôles sociaux : les femmes sont destinées à la sphère privée et domestique, tandis que les hommes évoluent dans la sphère publique. L'assignation au rôle de mère et d'épouse peut ainsi entraîner l'autocensure des femmes ou soulever un veto familial. S'ajoute une certaine représentation de leurs capacités intellectuelles présentées comme naturelles : "Leur caractère [prétendument] plus émotif nuirait par exemple à l'abstraction et aux études scientifiques", rapporte Marie-Élise Hunyadi. La chercheuse distingue également le taux d'étudiantes inscrites du taux d'étudiantes effectivement diplômées : "4 % des inscrites en lettres obtiennent leur licence et 4 % des étudiantes en médecine obtiennent leur doctorat. En sciences et en droit, elles sont de l'ordre de 15 %." L'abandon des études peut s'expliquer par un mariage, généralement suivi de la naissance d'un enfant, et de la nécessité de l'autorisation du mari.
Se fédérer pour encourager l'accès des femmes à l'université
À partir de l'entre-deux-guerres, les étudiantes représentent une proportion plus conséquente des élèves du supérieur. Afin de promouvoir l'accession des femmes aux études supérieures, la Fédération internationale des femmes diplômées des universités (FIFDU) se constitue en 1919 et multiplie les initiatives pour soutenir les aspirantes étudiantes : bourses, restaurants universitaires, congrès, soins médicaux et bibliothèques destinés aux femmes.
Aussi, les membres de la FIFDU intègrent des organisations internationales pour promouvoir l'accès des femmes aux études universitaires à grande échelle. Au sein de la Société des Nations, elles font valoir une expertise et espèrent faire la preuve, par leur travail, de la capacité des femmes à exercer des professions intellectuelles. Elles veulent "se faire voir comme des universitaires et des intellectuelles plutôt que comme des femmes", souligne Marie-Élise Hunyadi. "Elles glissent des revendications pour qu'on n'oublie pas les femmes, mais elles ne veulent surtout pas qu'on les voie comme des féministes qui viennent brandir la cause des femmes. Elles ont peur que cela nuise à leur image et à leur action."
Après la Seconde Guerre mondiale, les membres de la FIFDU se concentrent davantage sur l'éducation des filles et collaborent avec l'UNESCO. En France, ce n'est qu'après 1945 qu'une véritable féminisation de l'université s'observe, en parallèle du mouvement de démocratisation des études supérieures.
URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/federons-nous-quand-les-femmes-s-imposent-a-l-universite-7717948
mot(s) clé(s) : enseignement supérieur, histoire de l'éducation, recherche en éducation