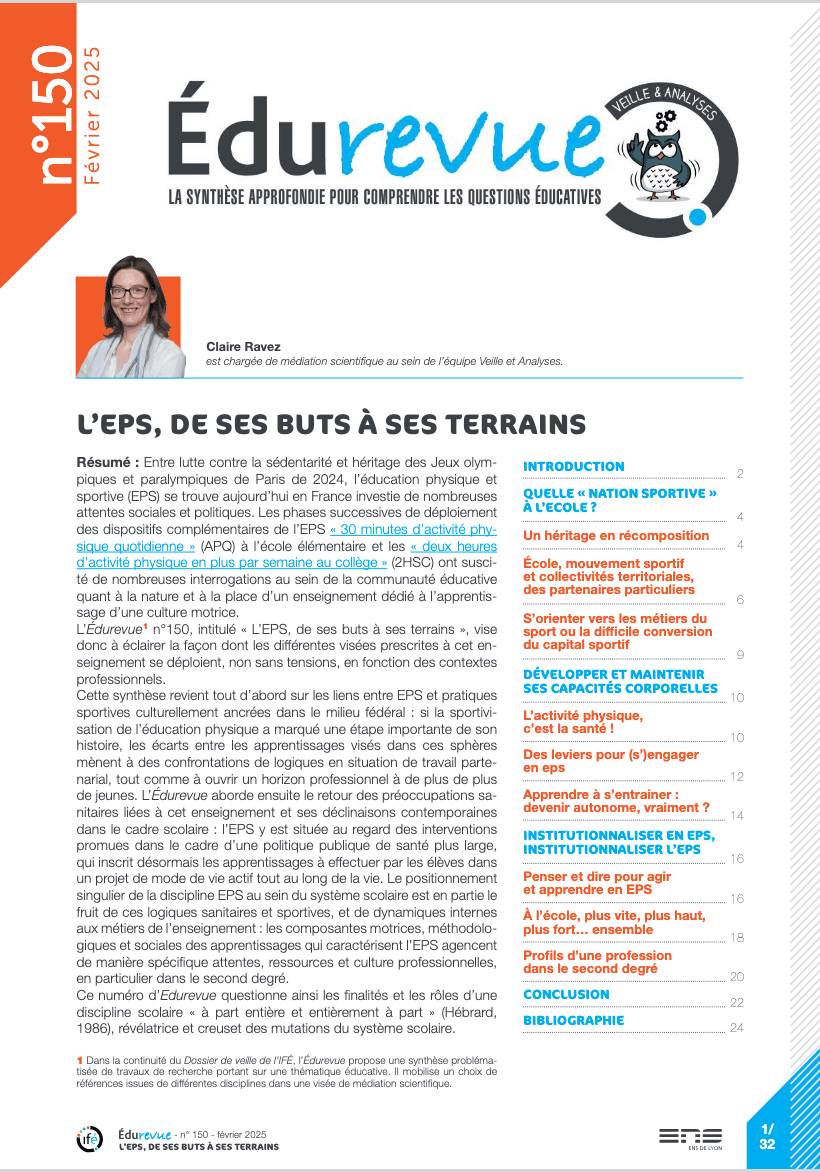Sur le chemin de l'université, une histoire studieuse (2/4). Romantiques, socialistes et pas contents! Étudiants dans le siècle des révolutions
Programme source : Le Cours de l'histoire
Produit par : France Culture, Xavier MAUDUIT
Animé par : Xavier MAUDUIT
Intervenant(s) : CANDAR Gilles & DUBOIS Antonin
Au 19ᵉ siècle, comment les étudiants militaient-ils ? En juillet 1830, des polytechniciens mettent leur savoir en ingénierie au service des révolutionnaires contre les ordonnances du roi Charles X. Sans avoir toujours le bac en poche, ces élèves ouvrent la voie au militantisme des étudiants.
Voilà là une figure incontournable des stéréotypes sociaux au siècle des révolutions : l’étudiant, plus ou moins fortuné, qui traîne ses guêtres du côté de l’université et qui divague parfois un peu plus loin, pour compter fleurette à quelques lorettes. C’est cet étudiant qui refait le monde, avec ses camarades et avec la ferme intention de jouer un rôle dans la société, au point d’agir dès que l’occasion se présente lors des agitations et des révolutions.
1848, printemps des peuples… et des étudiants
Au début du 19ᵉ siècle, les étudiants sont peu nombreux à l'échelle de l'Europe. "Quatre-vingts mille environ à l'échelle de l'Europe, Russie comprise", précise l'historien Antonin Dubois, auteur d'Organiser les étudiants. Socio-histoire d’un groupe social (Allemagne et France, 1880-1914) (Éditions du Croquant, 2021). L'année 1848 marque un tournant quand les révolutions fleurissent dans les villes européennes. C’est la première fois que les étudiants s'engagent à l’échelle internationale. Paris, Berlin, Vienne, Rome, "la figure de l'étudiant engagé dans les affaires politiques s'impose", relève Antonin Dubois. "Cela reste un moment exceptionnel, une brèche qui se referme avec les contre-révolutions dès la fin de l'année 1848 jusqu'aux années 1850", ajoute l'historien. Ces mobilisations inspirent de la méfiance aux autorités, y compris au sein des universités, qui les répriment fortement. Des textes fixent l'encadrement des étudiants afin de briser toute velléité de remise en cause du pouvoir. S'il existe des formes de groupe ou d'organisation estudiantines, elles se tiennent exclusivement de manière clandestine.
L'engagement politique n'est pas que l'affaire des étudiants révolutionnaires, contrairement à ce que l'imaginaire collectif peut laisser penser. "Il a aussi existé des étudiants contre-révolutionnaires. Sous la Restauration, des manifestations de lycéens et d'étudiants blancs ultra-royalistes existent", note l'historien Gilles Candar, qui a dirigé avec Guy Dreux et Christian Laval Socialismes et éducation au XIXᵉ siècle (Le Bord de l'eau, 2018) et Socialismes et éducation au XXᵉ siècle (Le Bord de l'eau, 2025).
L’union fait la force : se rassembler pour militer
Dans les espaces germaniques et français, la libéralisation des années 1870-1880 permet aux étudiants de s'imposer de manière plus durable. Le regard politique change et perçoit les étudiants comme de futurs piliers des nouveaux régimes en place. En Allemagne, la culture corporatiste induit une organisation de groupes étudiants précoce. Dans la France de la Troisième République, l’associationnisme estudiantin s’organise, soutenu par certains professeurs. L’affaire Dreyfus, qui court de 1898 à 1906, divise les esprits, y compris chez les étudiants socialistes. Ils organisent des conférences et fondent des revues pour diffuser leurs idées théoriques.
Les rassemblements internationaux se diversifient au même moment. En 1891 a lieu à Bruxelles le premier congrès des étudiants socialistes, tandis que d’autres organisations, majoritairement religieuses, rejettent la politique, à l'instar de la Fédération internationale des étudiants, aussi surnommée la Corda Fratres. En réaction, les fondateurs de la première fédération d’associations d’étudiants de France, l’ancêtre de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF), se positionnent contre cette organisation en 1907.
Quant aux partis politiques et aux syndicats, ils se méfient des étudiants, jugés trop imprévisibles ou bourgeois. "[Dans] la presse socialiste de la Troisième République, la figure de l'étudiant est traitée avec condescendance et un sentiment de supériorité. Ce sont des 'moutards' bourgeois, que l'ouvrier doit remettre au pas", fait remarquer Gilles Candar. Les Jeunesses socialistes sont ainsi fondées en 1912, soit sept ans après la SFIO.
Face au fascisme
Après les pertes engendrées par la Première Guerre mondiale, les milieux estudiantins, jusque-là largement masculins, sont en ébullition. En Europe, les étudiants de gauche se fédèrent pour faire face au fascisme. En France, les étudiants parisiens jouent un rôle décisif dans la montée au pouvoir du Front populaire en 1936. Dans les milieux de droite et d'extrême droite, des étudiants multiplient les actions militantes contre les étrangers. En 1935, par exemple, les étudiants médecins participent à l’abrogation d’une loi pour la naturalisation des étrangers.
La Seconde Guerre mondiale entraîne la recomposition des rapports entre les étudiants, les partis politiques et les syndicats.
URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/romantiques-socialistes-et-pas-contents-etudiants-dans-le-siecle-des-revolutions-3208821
mot(s) clé(s) : enseignement supérieur, histoire de l'éducation, recherche en éducation