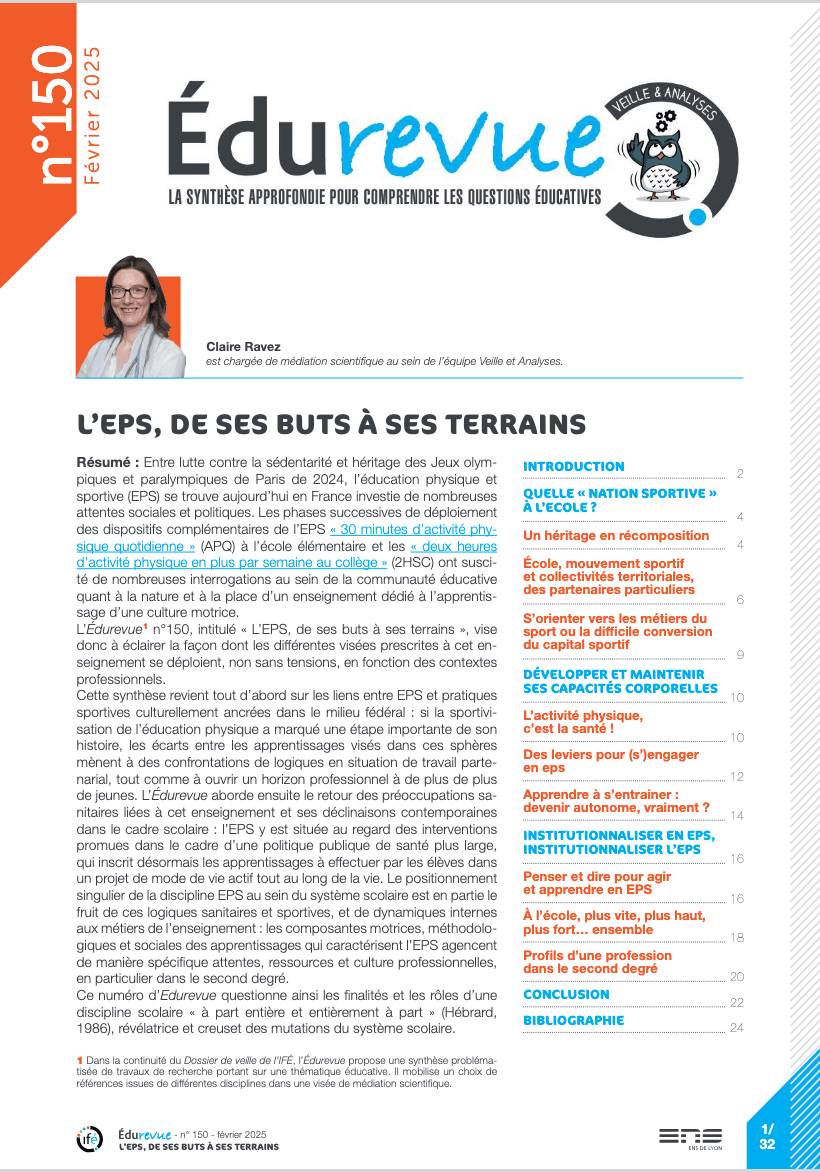Sur le chemin de l'université, une histoire studieuse (1/4). Un pécule pour l'étude, dans les pas des élèves boursiers
Programme source : Le Cours de l'histoire
Produit par : France Culture, Xavier MAUDUIT
Animé par : Xavier MAUDUIT
Intervenant(s) : LE BIHAN Jean
Au 19ᵉ siècle, la bourse de lycée se démocratise et s’ouvre progressivement à la bourgeoisie populaire. Malgré la création du concours, la bourse de lycée reste longtemps réservée à une élite qui fait partie des serviteurs de l’État.
Voici un personnage qui traverse l’imaginaire scolaire depuis le 19ᵉ siècle : l’élève boursier. Il serait réducteur de le présenter comme un élève particulièrement méritant, issu d’un milieu modeste, que l’État a décidé d’aider, pour son intérêt personnel, mais aussi celui de la nation. Qui sont les boursiers ? Comment l’étude de l’attribution des bourses nous renseigne-t-elle sur l’enseignement secondaire en France et sur la société ?
En 1802, vive la bourse de lycéen !
Le système de bourse existe sous l’Ancien Régime et perdure sous la Révolution française. Il s’agit souvent d’aider des jeunes gens à des carrières cléricales par l'attribution d'une pension pour accéder à un collège. Le 1ᵉʳ mai 1802, la loi sur l’instruction publique invente un nouveau système d’aides : la bourse est créée en même temps que les lycées. Le Consulat puis l’Empire créent des "places gratuites" pour peupler les lycées qui peinent à se remplir, faute de popularité. "Au départ, les 'élèves payants' sont peu nombreux. La bourgeoisie boude les lycées", relève l'historien Jean Le Bihan, auteur de Bourses et boursiers de l’enseignement secondaire en France, 1802-1914 (Presses universitaires de France, 2024). "Les bourses sont l'outil de financement des lycées. Cette fonction va rester prépondérante pendant quelques décennies tant que les lycées ne deviennent pas autonomes financièrement." L’accord de bourses aux nouveaux lycéens permet également de fabriquer la future élite administrative dont le régime a besoin pour fonctionner.
Les premiers lycéens boursiers sont choisis en fonction du titre de leur père. "À travers le fils, on entend rémunérer le père pour les services qu'il a rendus à l'État", précise Jean Le Bihan. Ce sont pour la plupart des fils de militaire, de fonctionnaire civil, judiciaire ou administratif. Ce système de recrutement perdure sous la Restauration et la monarchie de Juillet. À partir de 1848, une rupture intervient avec la création d’un concours. À présent, les lycéens peuvent obtenir une bourse par leur seul talent individuel. Le jeune garçon est obligé de passer des épreuves, même symboliquement. "Le classement des lauréats s'impose au ministère qui, théoriquement, doit nommer des lauréats dans l'ordre même du classement. Les républicains en 1848 continuent de faire une petite place, quand même, au recrutement pour services familiaux", fait remarquer l'historien. Néanmoins, "ce concours est entouré d'un ensemble de garanties nouvelles. Pendant trois ans, cette modification réglementaire entraîne une petite ouverture sociale du monde des boursiers."
Dans les milieux populaires, cette étape est parfois intimidante et de nombreuses familles ont recours à un tiers pour formuler les demandes de bourse. Le voisin lettré comme l'instituteur aident de fait les parents modestes à formuler des demandes. Cette ouverture de la Seconde République reste éphémère. Dès 1852, le Second Empire supprime le concours et ne garde, en contrepartie, que l’examen d'aptitude. "La voie du recrutement pour compétences individuelles scolaires est supprimée sur le papier. [...] C'est la première fois qu'un régime dit ouvertement que les bourses sont réservées aux enfants des serviteurs de l'État", observe Jean Le Bihan.
L’expérience de lycéen boursier
L’institution de la bourse de lycée ne fait pas consensus dans le débat public au 19ᵉ siècle. Elle est au cœur d’enjeux de mobilité et de rapports entre les classes sociales. De nombreux conservateurs et traditionalistes sont hostiles à l’égard de l'accroissement des bourses et certains s’opposent à leur principe même. Ces opposants mettent en avant la peur du déclassement. Selon Jean Le Bihan, "la peur que la bourse génère des déclassés est articulée, à la fin du 19ᵉ siècle, à la critique du fonctionnarisme. Le boursier, précisément parce qu'il est entretenu par l'État, [serait] un fonctionnaire au petit pied. [...] Cette critique prend une certaine ampleur, en particulier en littérature. Deux romans particulièrement célèbres critiquent le boursier en l'incarnant dans une figure : Les Déracinés de Maurice Barrès et L'Étape de Paul Bourget."
Les libéraux sont davantage favorables aux bourses qui entrent dans leur conception de l’édifice social. La bourse permet à des jeunes gens ayant un talent individuel de s’élever afin de rendre, à l’avenir, un service à la nation. Au sein des classes, l’expérience des lycéens boursiers est parfois éloignée des discours et stéréotypes qui se construisent à leur égard. À l’encontre du mythe du boursier conquérant, les jeunes lycéens d’origine modeste font parfois l’expérience de la différence de classe. Loin de représenter un groupe homogène, les lycéens boursiers ne réussissent pas tous à être d’excellents élèves, qui surpassent leurs camarades malgré leur origine sociale modeste. L’expérience des lycéens boursiers varie également en fonction du type de bourse reçue : elle peut être étatique, départementale ou communale.
La Troisième République, vers la méritocratie ?
La Troisième République marque une rupture. Bien que le régime refuse le retour au concours, la période est marquée par une plus grande prise en compte de la capacité scolaire des élèves. La démocratisation de la bourse de lycée s’accélère. En 1882, l’homme politique Paul Bert édicte la règle de publication des lauréats boursiers dans le Journal officiel. À présent, les lycéens boursiers sont des jeunes gens qui le méritent, jugés sur leurs compétences individuelles, selon l’idéal républicain de la période. La représentation sociale des boursiers se sophistique également. Dans les manuels scolaires, les dictées campent le boursier comme l’exemple du bon élève en classe. Par ailleurs, les bourses d’État s’ouvrent aux collèges et lycées de jeunes filles à partir de 1882.
Né à Aubagne en 1895, le jeune Marcel Pagnol possède un parcours caractéristique du boursier conquérant. Fils d’instituteur, élève sous la Troisième République, le jeune Pagnol passe l’examen des bourses en 1905 avant de rejoindre le lycée Thiers de Marseille. Plus tard, il évoque sa rentrée des classes dans ses Souvenirs d’enfance, écrits en plusieurs tomes entre 1957 et 1977. À côté, il reste le parcours de tous les autres lycéens boursiers, assis dans les rangs et restés anonymes. Aux historiens et historiennes de les raconter.
URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/un-pecule-pour-l-etude-dans-les-pas-des-eleves-boursiers-3170144
mot(s) clé(s) : enseignement supérieur, histoire de l'éducation, recherche en éducation