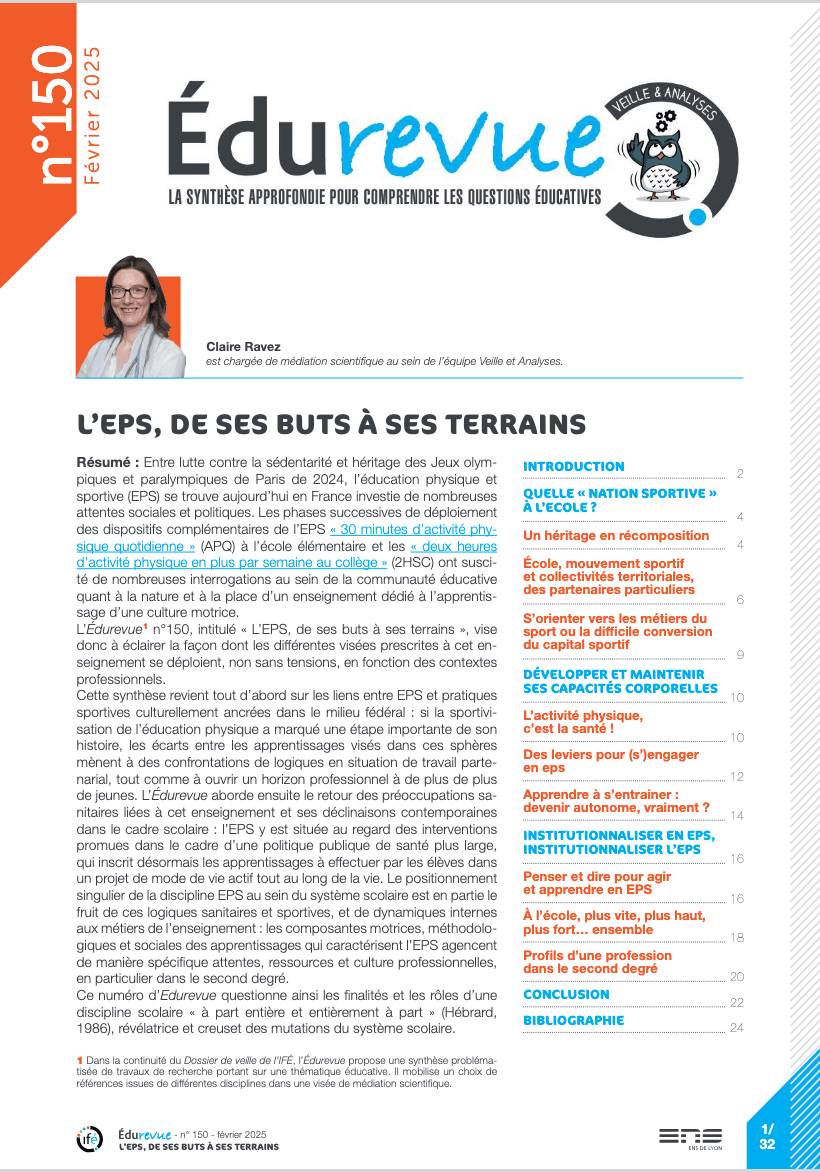Planifier, réformer, et bricoler, histoire du budget de l'école
Programme source : Le Cours de l'histoire
Produit par : France Culture, Xavier MAUDUIT
Animé par : Xavier MAUDUIT
Intervenant(s) : CARDON-QUINT Clémence
Le budget de l’enseignement scolaire a connu une augmentation massive entre le 19ᵉ siècle et le 21ᵉ siècle et devient la première mission du budget général de l’État. Comment expliquer cette croissance des dépenses d’enseignement dans l’histoire des finances publiques ?
Est-il nécessaire de dépenser plus pour enseigner plus, et mieux ? À la croisée des questions sociales, économiques et politiques, se trouve le budget de l’Éducation nationale. Au fil du temps, il augmente, c’est certain, tout comme le nombre d’élèves, d’enseignants, de personnel de la vie scolaire, sans oublier les bâtiments qu’il faut construire et entretenir pour accueillir tout ce petit monde. C'est une histoire de l'argent de l'école.
Financer l'école, un projet républicain
Le 19ᵉ siècle voit la mise en place de premières politiques éducatives suivies, qui demandent un investissement financier plus important. La loi Guizot de 1833 sur l’instruction primaire ou la loi Camille Sée de 1880, qui crée l’enseignement secondaire public de jeunes filles, sont des jalons qui voient s’accroître peu à peu le nombre d’élèves. Le véritable tournant est celui des lois Ferry de 1881-1882, qui mettent en place une instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque. Avec la politique scolaire républicaine et l’essor de la scolarisation, la charge du financement de l’éducation est transféré à l’État, à travers l’impôt. "Au départ, l'enseignement [était] financé par les familles et par les communes", explique l'historienne Clémence Cardon-Quint, autrice de L’Argent de l’école. Histoire du budget de l’Éducation nationale depuis 1945 (Presses de Sciences Po, 2025). "Un élément essentiel de la politique républicaine, pour enraciner la République, est de développer et consolider l'instruction primaire, déjà présente dans la plupart des villages. Cela passe par un effort financier."
L’héritage des guerres du 20ᵉ siècle, avec leur lot d’évolutions démographiques, font à nouveau augmenter les crédits du budget général de l’éducation. L’ambition démocratique et la recherche d’une plus grande égalité dans le domaine scolaire conduisent à la prolongation des scolarités, avec le report de l’obligation scolaire à 14 ans en 1936. La gratuité dans l’enseignement secondaire est généralisée en 1933. De nouveaux besoins naissent, qui nécessitent un financement public. Il s’agit de rénover ou de construire de nouveaux locaux, mais aussi de former les professeurs.
URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/planifier-reformer-et-bricoler-histoire-du-budget-de-l-ecole-7914412
mot(s) clé(s) : économie de l'éducation, histoire de l'éducation, recherche en éducation