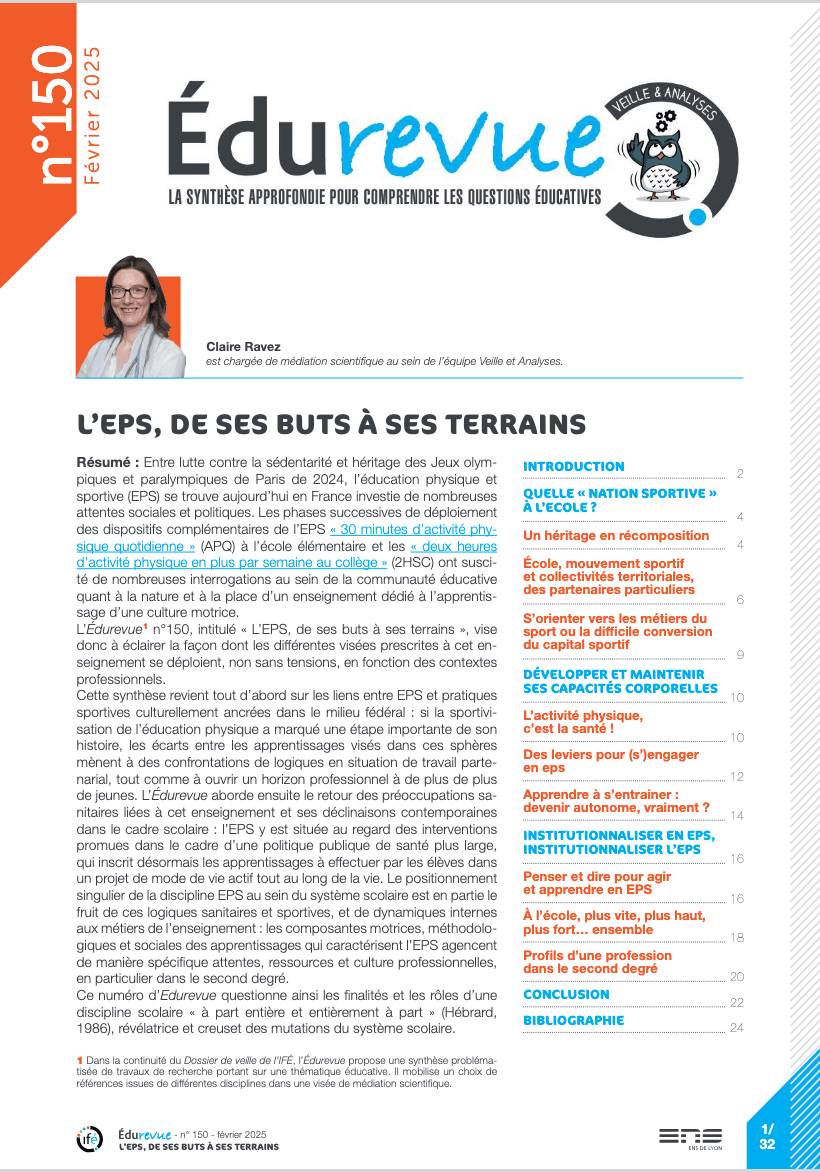Repenser l'animation socioculturelle à l'ère du numérique - Inclusion, éducation et engagement
Date : du 26-01-2026 au 27-01-2026
Appel à communications ouvert jusqu'au : 03-11-2025
Lieu : Bordeaux
Modalité : présentiel
Organisation : Pôle Carrières Sociales ISIAT - IUT Bordeaux Montaigne - UMR CNRS 5319 PASSAGES - Université Bordeaux Montaigne
Le Pôle Carrières Sociales ISIAT-IUT Bordeaux-Montaigne, l’UMR CNRS 5319 PASSAGES, l’Université Bordeaux-Montaigne, en partenariat avec l’École Polytechnique de Lisbonne, l’Université de Malaga, le CRAJEP-NA, le CNFPT,Chaire UNESCO ISNoV (Intervention sociale non-violente) et le laboratoire MICA organisent le 42ème colloque international de l’ISIAT qui se déroulera à Bordeaux les lundi 26 et mardi 27 janvier 2026.
Programme :
L'émergence du numérique transforme profondément les pratiques culturelles, éducatives et sociales de nos sociétés. Dans le champ de l'animation socioculturelle et de l'éducation populaire, ces mutations ne sont ni anecdotiques ni secondaires : elles s'inscrivent dans les modalités de coopération et d'échange au sein des mouvements d'émancipation, d'apprentissage non formel et d'engagement citoyen (Besse L. et al., 2021). L'éducation populaire a toujours su s'approprier les outils de son époque : imprimerie (Go, 2022), radio (Poulain, 2022), vidéo (Ducellier, 2025), théâtre-forum (Sacco, 2024). À ce propos, Hélène Grimbelle (2017) affirme que le numérique, loin d'être un simple support technique, reconfigure aujourd'hui les formes d'action collective, les modes de médiation, les stratégies d'appropriation du savoir et les rapports aux institutions.
Dans différents contextes : les territoires (urbains, ruraux, quartiers prioritaires), les équipements socioculturels (centres sociaux, ludothèques, bibliothèques, tiers-lieux), les associations et les établissements scolaires de nombreux professionnels de l’animation expérimentent déjà des pratiques numériques avec différents objectifs : l'inclusion, la visibilité, la participation ou bien la créativité. Mais ces pratiques restent encore insuffisamment documentées et pensées dans leur globalité ou dans leurs problématiques. Si .le numérique peut être un levier de médiation et d'inclusion (Deydier, 2019), il peut aussi reproduire, voire aggraver, certaines inégalités sociales, culturelles et territoriales. Il interroge ainsi directement les valeurs fondatrices de l'animation socioculturelle : accès à l'autonomie, à la parole, à la culture et au pouvoir d'agir (Fretin, J.).
À l'heure des plateformes, de l'intelligence artificielle, des politiques publiques de « transformation numérique », mais aussi de la montée des logiques de contrôle, de captation des données et de dépendance aux infrastructures privées, il devient urgent d'interroger les usages numériques dans l'animation socioculturelle sous un angle éthique, politique, culturel, mais aussi économique, éducatif et symbolique. Qui conçoit les outils numériques pour le monde associatif ou éducatif aujourd'hui, et selon quelles logiques ? Le numérique est-il un levier de transformation sociale ou un vecteur de dépendance ? Quels savoirs sont mobilisés, quels savoir-faire sont invisibilisés, et quels apprentissages sont rendus possibles ou, au contraire, empêchés ?
Les représentations du monde et les imaginaires numériques que ces outils véhiculent méritent aussi d'être questionnés (Carton, 2019). Sont-ils mobilisés de manière critique et/ou réappropriés collectivement ? Le numérique peut-il encore être un espace d'expérimentation, de résistance ou d'émancipation, dans un contexte marqué par la standardisation du numérique ?
Les conditions dans lesquelles on peut faire émerger une culture numérique partagée, libre, inclusive, voire subversive, doivent être re-définies (Vacaflor et al., 2020). Mais comment les professionnels de l'animation peuvent-ils se positionner face à ce langage numérique à la fois commun et disputé ? Voilà la question principale de ce colloque. Les dispositifs qui existent aujourd’hui peuvent encourager une approche critique et créative du numérique dans les pratiques éducatives et sociales.
Ces journées visent à créer un espace de réflexion, d'échange et de valorisation de pratiques innovantes et critiques, à la croisée de plusieurs mondes : celui de l'intervention sociale, de l'éducation populaire, de la recherche universitaire, de la médiation culturelle et de l'action citoyenne et l'animation sociale. Ces journées proposeront un équilibre entre communications académiques, retours d'expériences de terrain, ateliers participatifs et présentations de projets. Une attention particulière sera portée à la pluralité des formats, à la dimension expérientielle et accessible des échanges, ainsi qu'à l'accueil de contributions issues de collectifs hybrides, de structures locales et internationales ou de démarches collaboratives.
- Axe 1 – Inégalités numériques et inclusionAxe 2 – Cultures numériques, pratiques sociales et éducation critique
- Axe 3 – Pratiques numériques en animation et éducation populaire : coopérations, solidarités et alternatives
- Axe 4 – Intelligence artificielle, robotique et animation socioculturelle : les mutations en cours
Appel à contribution complet en ligne.
URL : https://calenda.org/.../1280932
mot(s) clé(s) : culture médiatique et numérique, éducation culturelle, artistique et musicale, Education populaire